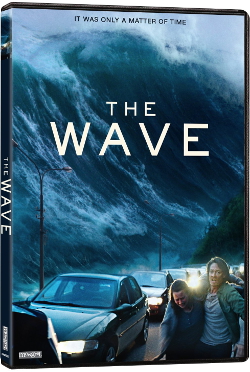Les documentaires animaliers sont nombreux. La plupart s'appuient sur une narration pour véhiculer de l'information. D'autres optent pour un processus d'anthropomorphisme afin de faire «parler» les bêtes. Puis il y a Denis Côté qui jouait à un passionnant jeu d'observations sur Bestiaire.
À l'instar du récent et prenant Stray qui suivait des chiens errants à Istanbul, le cinéaste russe Viktor Kossakovsky propose avec Gunda de se rapprocher au plus près des animaux de la ferme, laissant au vestiaire les commentaires et la musique. Les cadrages sont serrés et on ne voit que les cochons, vaches et autres poules. Une immersion totale qui utilise à bon escient toutes les possibilités de son art. Les longs plans contemplatifs révèlent l'état d'esprit des animaux, alors que l'utilisation du son ambiant plonge littéralement le spectateur dans le feu de l'action.
Ce procédé était déjà la norme d'Aquarela, le magnifique précédent essai du réalisateur qui portait sur les conditions climatiques. Le cinéma est un médium d'images et ce sont elles qui enchantent au plus haut point. Mais comment la caméra est parvenue à capter tous ces détails? La somptueuse photographie ne finit plus d'impressionner, transformant son noir et blanc en véritables séances d'expressionnisme allemand.
Un combat entre l'ombre et la lumière qui est au cœur même du film : la mort n'est jamais loin de la vie. Un cochonnet laissé à l'écart a tôt fait de disparaître de la circulation, alors que l'errance salvatrice d'un poulet à une patte ressemble à l'expédition d'un soldat en terrain étranger. L'horreur risque de survenir à chaque instant de ce hors-champ menaçant puisque c'est la nature souvent brutale qui a le dernier mot. À côté de ça, Babe n'est rien d'autre qu'un conte édulcoré pour enfants.
Ce qui est remarquable dans Gunda et qui, ironiquement, risque de laisser plusieurs personnes sur la touche, c'est que le long métrage demande aux cinéphiles de construire leur propre narration. Il n'y a pas seulement à l'écran des images d'animaux en mouvement, des plans répétitifs, du bruit et des grognements, mais c'est au contraire la vie qui s'anime patiemment, débordant constamment de son cadre.
Presque rien ne pourra arrêter ces balbutiements et le rythme lent (la notion du temps est au cœur même de l'essai) permet de saisir ce que les yeux ne regardent plus. La beauté de la nature, évidemment, mais également cette faune qui aspire seulement à un peu de quiétude. Comme ces vaches qui, en regardant longuement la caméra, dévoilent une certaine part d'humanité, faisant soudainement écho au Visitors de Godfrey Reggio.
Ces liens entre eux et nous — de toute façon, nous sommes tous des bêtes — au niveau de l'amour filial, de la violence, du désir de liberté et de la résilience atteignent leur apothéose lors d'une finale crève-cœur qui aurait eu sa place à l'époque du néoréalisme italien. Nul ne peut résister au rouleau compresseur de l'Homme et les êtres vivants qui ont eu la vie sauve ne peuvent que constater les pertes et ressentir le manque. Une entrée en matière foudroyante et la parfaite introduction au Sang des bêtes de Georges Franju, sans doute un des documentaires les plus insoutenables du septième art.
Misant sur l'immersion et l'expérimentation afin de susciter une expérience unique de cinéma (voilà une œuvre qui mérite absolument d'être découverte en salle), Gunda remplit sa mission, même si le film aurait pu pousser sa radicalité encore plus loin. Ce sera peut-être trop pour certains appétits, mais la plupart voudront sans doute se convertir au végétarisme après avoir assisté au quotidien d'animaux si familiers.